Réactions, enquêtes, déclarations...
Toutes les news c'est ici Contact
Abonner un(e) ami(e) Vous abonner Qui sommes no |
|
04.05.2025 - N° 1.985 4 minutes de lecture
Pourquoi l’Europe ne pourra pas contrôler l’évolution de l’IA Par Élodie Messéant Diplômée en droit privé et en philosophie du droit, Élodie Messéant a travaillé dans le domaine de l'investissement et des cryptomonnaies. Chargée d'études à l'IREF, elle écrit régulièrement dans la presse depuis 2017.. 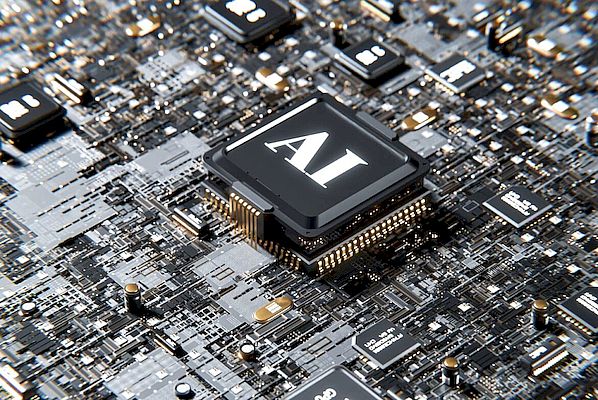 L’IA générative, capable de produire du texte, des images ou du code à partir de simples instructions, a bouleversé les usages numériques. Lancé en 2022, ChatGPT a atteint 100 millions d’utilisateurs mensuels au bout de deux mois, soit 4,5 fois
plus rapidement que le réseau social Tiktok et 15 fois plus
qu’Instagram. La vitesse à laquelle l’IA a été adoptée bat à plates
coutures la capacité d’institutions comme l’UE à réglementer et à
contrôler. Derrière l’effet de mode, l’IA suit une trajectoire continue de progrès technologiques. Dans des domaines comme la reconnaissance d’images, la compréhension écrite, le raisonnement visuel, le travail multitâche ou les concours de mathématiques, l’IA a dépassé les compétences des humains, comme on peut le constater dans l’index IA 2025 de l’université de Stanford (page 93). Il est essentiel de comprendre les étapes de cette progression pour bien en saisir les enjeux. La croissance de l’IA : entre fantasme et réalité L’IA n’a pas émergé brutalement, elle s’est développée par étapes successives. 1- L’intelligence artificielle étroite (ANI), ou IA faible, se limite à l’exécution de tâches bien précises selon des règles déterminées. Elle ne « comprend » pas ce qu’elle fait, mais applique des modèles statistiques ou logiques à des cas spécifiques. Des systèmes comme Deep Blue (IBM, 1997), Stockfish (2008) ou AlphaGo (2015), par exemple, excellent dans un domaine unique sans pouvoir en sortir. 2- L’intelligence artificielle générale (AGI), ou IA forte, serait, elle, capable de mémoriser et de contextualiser. Si le seuil n’est pas officiellement franchi, certaines avancées laissent penser qu’on s’en rapproche. Les modèles tels ChatGPT peuvent simuler des interactions complexes, générer du code, raisonner logiquement ou répondre à des questions ouvertes sur des sujets variés. Dans la version o3, l’IA présente des comportements étrangement proches de l’humain lorsqu’elle essaie de tromper l’utilisateur sur des actions qui n’ont pourtant jamais été réalisées – en l’occurrence, le fait de générer du code en dehors du chatbot. Pour l’instant, les modèles souffrent encore de biais et d’« hallucinations » – ces moments où l’IA invente des informations plausibles mais erronées. 3- La superintelligence artificielle (ASI) marque le moment où une IA pourra dépasser les capacités cognitives humaines dans tous les domaines, voire simuler le fonctionnement du cerveau humain – ce qui impliquerait de plus grands volumes de données et des réseaux neuronaux plus complexes que ceux qui sont utilisés actuellement. Elle est encore hypothétique, mais des chercheurs s’intéressent de près à l’informatique neuromorphique et au calcul évolutionnaire. Dans cette perspective, l’IA pourrait accélérer les découvertes scientifiques, et même redéfinir la place de l’homme dans la chaîne de décision. Les États-Unis et la Chine dominent À ce stade, l’enjeu est de savoir qui en contrôlera l’orientation, les cas d’usages et la vitesse de déploiement. Si l’IA progresse à pas de géant, tous les continents ne sont pas logés à la même enseigne. L’Europe possède certes d’excellents centres de recherche, mais les modèles les plus avancés ne sont que très rarement européens : en 2024, 40 ont été conçus aux États-Unis, 15 en Chine et 3 en France. De la même manière, 2,77 % des brevets liés à l’IA ont été déposés en Europe en 2023, contre 14,2 % aux États-Unis et 69,7 % en Chine. Cette domination se retrouve également au niveau des infrastructures : 98 % des puces GPU utilisées pour entraîner les modèles sont produites par Nvidia, entreprise américaine. Entre 2010 et 2025, la puissance de calcul informatique nécessaire pour entraîner des systèmes notables d’IA a augmenté de manière exponentielle : 4,7 fois chaque année. Les dépenses en serveur consacrées à l’IA sont passées de 25 milliards de dollars en 2022 à 125 milliards en 2025. Pour autant, l’Europe n’héberge que 18 % des centres de données à échelle mondiale, dont à peine 5 % appartiennent à des entreprises européennes – contre 37 % pour les États-Unis. Pendant que les autres innovent, l’UE réglemente En 2025, seulement 13,5 % des entreprises de l’UE ont adopté l’IA. La Commission européenne n’a alors rien trouvé de mieux que de lancer une nouvelle stratégie, « Appliquer l’IA », avec un plan d’investissements de 20 milliards d’euros pour créer « quatre à cinq gigafactories » et tripler la capacité des centres de données. Sauf que ce n’est pas le rôle des technocrates de l’UE de redistribuer l’argent des contribuables pour investir : l’innovation ne se décrète pas ; elle se construit par des initiatives entrepreneuriales, une culture du risque et des conditions propices à l’expérimentation. Il y a plus inquiétant : l’AI Act, la réglementation européenne en la matière, prévoit plusieurs chapitres qui traitent notamment des pratiques interdites, des obligations de transparence, des mesures pour « soutenir l’innovation », définit un code de conduite, imagine des sanctions… Malgré son ambition, la Commission risque de produire un effet délétère : étouffer ce qui pourrait émerger localement, tout en étant incapable de concurrencer les géants américains ou asiatiques. De l’urgence d’une vision stratégique L’IA en est actuellement à un stade qui peut rappeler les débuts de l’électricité au XIXe siècle ou ceux d’Internet. Hélas, et c’est là un problème de fond, tout montre que l’UE la considère d’abord comme un risque à contrôler, là où d’autres nations la conçoivent comme un levier de puissance à exploiter. L’UE ne souffre pas d’un manque de talents, mais d’un manque de lucidité. Tant qu’elle abordera l’IA sous un angle réglementaire, elle ne pourra ni infléchir le cours de son évolution, ni garantir sa « souveraineté ». Auquel
cas, dans la course mondiale, les entreprises européennes devront se
contenter de rester des spectateurs, sans pouvoir monter sur scène.
On serait tenté de dire : comme d’habitude ! ______________
| |||
| Qui
sommes-nous ? Nous écoutons, nous lisons, nous regardons... C'est parfois un peu ardu, et les news peuvent demander de l'attention. Mais elle sont souvent remarquables ! Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion et nourrir celle-ci. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs, et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation. Bien sûr, vos commentaires sont très attendus. |
